Brigitte Leroy-Viémon, artiste peintre
Une temporalité et des espaces de silence qui s’ouvrent, c’est très vivant et le silence, c’est très lumineux aussi. Aujourd’hui, si j’ai une ambition c’est celle-ci : faire place au silence.
Comment as-tu commencé à dessiner ?
J’ai toujours dessiné, grâce à mon père, instituteur. Nous habitions en campagne dans un coin très reculé à l’époque où il n’y avait pas d’autres distractions que jouer, manger, dormir et discuter. Parfois, mon père me disait « tu ne veux pas qu’on dessine ? ».
Il avait récupéré de grands rouleaux de papier de 2 m sur 15 dans une ancienne imprimerie de la presse quotidienne. Il déroulait le papier sous le préau. Il mettait des bûches de bois pour tenir les bouts. Nous dessinions à la gouache : des jungles avec des animaux, des ciels avec tout un tas d’oiseaux, des scènes presque bibliques. Nous avons dessiné des personnages assis en train de festoyer. Nous trouvions cela magnifiquement beau et il me disait « tu vois pour que tu puisses dessiner toute ta vie, il ne faut jamais t’arrêter ». J’ai suivi son conseil.
J’ai vite trouvé du plaisir dans le fait de dessiner et dans la couleur. Quand on est enfant, on fait des ciels rouges, des mers jaunes des bateaux parfois bleus. On se fiche des conventions. C’est comme un déconditionnement. C’est jouissif.
As-tu appris des techniques avec lui ?
Oui. La mine graphite, le pastel sec, le stylo bille de couleur, l’encre de chine, la gouache… Comme c’était à l’école, il avait des grands pots de peinture d’un litre qui étaient toujours là. On se mettait à peindre à plusieurs enfants et j’ai adoré cela. Un jour, j’étais en CM2 et un élève qui s’appelait Hugues a fait un héron à côté de moi. J’avais fait un personnage féminin et je trouvais que le héron n’allait pas à côté d’elle. Je lui ai dit « qu’est-ce que tu fais ? ». Il m’a répondu « un héron ». Je lui ai dit « mais non, car moi je fais une sorte de princesse ». Il m’a dit « que cela allait très bien ensemble ». Alors j’ai arrêté de peindre. Mon père m’a demandé ce qui se passait et je lui ai répondu « Dis à Hugues de ne pas faire le héron aussi prêt ». Il m’a répondu « pour Hugues, ce héron doit être là ». J’ai mis des semaines à accepter que le héron était à sa place, ça a été difficile !
Je crois que d’avoir accepté ce héron a changé des choses pour moi. Je me suis sentie moins seule.
Tu étais enfant unique ? Des évènements de ta vie ont-ils eu une influence dans ton désir de dessiner et de peindre ?
J’ai un frère plus jeune que moi de trois ans. Mais j’ai eu trois maladies graves. L’une lorsque j’étais bébé, je suis restée la première année de ma vie une longue période à l’hôpital, séparée de mes parents. J’ai fait de l’anorexie. Ensuite à 4 ou 5 ans, j’ai été hospitalisée pour une coqueluche. Pour la troisième maladie, j’avais environ 6 ans, je suis restée pratiquement couchée sans aller à l’école pendant de longues semaines. Le matin, mon père me portait dans le salon et le soir dans ma chambre. Comme nous vivions au-dessus de l’école, dans la journée, j’étais dans le silence. Cependant j’entendais les cris des enfants lors des récréations. Je me suis alors vécue comme en bordure du monde, je ne sais pas si j’en ai souffert. Maintenant, j’aime cela, être en bordure, en retrait.
Parfois, lorsque j’étais couchée je voyais des scènes sur la tapisserie, une toile de Jouy avec des bergers. Mais, j’y voyais autre chose : des motifs en couleur alors qu’elle était en noir et blanc. J’ai vu des choses mouvantes et je me rappelle que je me disais « quand la vie va recommencer, je pourrais faire ceci, dessiner cela ».
Après je me suis laissée prendre dans un désir familial qui n’était pas le mien. Cela m’a conduit à faire un métier que je n’ai pas aimé faire jusqu’à l’âge de 26 ans. Je me sentais obligée de le faire. Pendant tout ce temps, j’ai continué à dessiner avec du graphite, du fusain, de l’encre de chine, beaucoup de noir et blanc. Pas trop la couleur. Je n’osais pas mettre en branle autre chose. Je n’osais pas troubler l’ordre établi par ceux que j’aimais…
Par la suite, as-tu eu un enseignement artistique ?
J’étais à Dijon à l’École Normale. Je suis allée aux cours des beaux-arts, le soir, pendant trois ans. J’y allais plus pour rencontrer des gens qui me plaisaient. J’étais à l’École Normale, c’était très conformiste. Je sortais de ma cambrousse, j’étais habillée comme une grand-mère. J’arrivais dans cette ville ouverte alors que j’ai été vissée dans mon enfance -sauf pour le dessin. J’étais impressionnée, un peu perdue.
A l’École Normale c’était donc très conformiste. Au bout de 3 mois je me suis dit « c’est ça la vie, c’est terrifiant ! ». Je suis allée aux beaux-arts 4 soirs par semaine. J’ai fait du nu, du portrait, j’ai appris des choses. J’étais focalisée sur le dessin, le contour, la couleur comme un art enfantin, comme un art brut. Là, j’ai découvert l’ombre et la lumière, la profondeur. J’ai utilisé des techniques mixtes ; l’acrylique, le pastel.
J’ai vécu à Nantes, à Montpellier, à Paris. J’ai pris des cours de dessin, ce qui se présentait. C’était surtout pour pratiquer avec des gens.
As-tu été influencée par l’une ou l’autre de tes expériences ?
 A Paris, j’ai travaillé dans une maison de couture, de prêt-à-porter. J’étais coursière et je portais les dessins des stylistes à l’atelier d’impression des tissus. Les rotatives de tissus et ces imprimés en immense dimension m’ont fascinée. J’adorais aller à l’atelier. Je voyais des ouvriers en blouse faire un travail de mécanicien pour sortir des imprimés magnifiques au km. Cela a dû m’influencer. Ce n’était pas conscient mais j’ai commencé à dessiner des aplats colorés. Un travail de motif, de traitement du trait. Je suis allée en bibliothèque et me suis intéressée à l’art arabo-musulman. Non figuratif. Parfois les stylistes se déplaçaient pour voir les imprimés en grande dimension. Cette vision les aidait à la création d’autres motifs encore. J’ai toujours aimé cette continuité entre la manufacture, la fabrication en atelier, et l’art proprement dit.
A Paris, j’ai travaillé dans une maison de couture, de prêt-à-porter. J’étais coursière et je portais les dessins des stylistes à l’atelier d’impression des tissus. Les rotatives de tissus et ces imprimés en immense dimension m’ont fascinée. J’adorais aller à l’atelier. Je voyais des ouvriers en blouse faire un travail de mécanicien pour sortir des imprimés magnifiques au km. Cela a dû m’influencer. Ce n’était pas conscient mais j’ai commencé à dessiner des aplats colorés. Un travail de motif, de traitement du trait. Je suis allée en bibliothèque et me suis intéressée à l’art arabo-musulman. Non figuratif. Parfois les stylistes se déplaçaient pour voir les imprimés en grande dimension. Cette vision les aidait à la création d’autres motifs encore. J’ai toujours aimé cette continuité entre la manufacture, la fabrication en atelier, et l’art proprement dit.
Avec cette expérience, j’ai découvert une petite gymnastique de l’œil que j’aime faire maintenant. Mon regard n’est plus jamais arrêté par un cadre ou par une dimension. Je vois dans un prolongement infini. Je suis aidée aussi en cela par le yoga.
Quand je suis en relation avec des gens, j’aime les appréhender aussi dans leurs prolongements. J’ai eu un cabinet de psychothérapie pendant une quinzaine d’année et je faisais régulièrement cela avec les patients. La psychothérapie est une co-fabrication du psychologue avec le patient. Dans ce compagnonnage, j’essayais de me donner à eux et de les envisager dans leurs prolongements. J’ai souvent pensé que lorsqu’on accueille quelqu’un dans ses prolongements, il prend conscience de ses potentiels – une conscience sensible, pas intellectuelle – et en fait quelque chose de créatif. Je trouve que c’est fécond de travailler comme cela.
As-tu fait d’autres expériences ou rencontré des personnes qui ont eu une influence sur ta pratique ?
Grâce à certaines personnes, j’ai découvert et développé une nouvelle disposition intérieure. Depuis, quand je peins, j’essaie de ne pas penser. Ce n’est pas facile car je suis quelqu’un qui se contrôle trop. J’ai fait une formation de yoga avec Peter et Colette Hersnack. Je rends hommage à Peter qui est décédé en mars 2016. Je ne l’ai connu que 3 ans mais il m’a beaucoup apporté. Il continue de m’apporter énormément. Grace au yoga et à d’autres expériences, j’arrive à contrebalancer cet aspect de moi qui est dans le jugement, le contrôle, la maitrise et une certaine raideur. J’arrive de plus en plus à me déconditionner de cela. Quand je peins, c’est comme une méditation, je ne prémédite pas.
Quand j’ai terminé un tableau, dans un premier temps, je vois d’abord en lui de la raideur. Une certaine part de moi. Mon premier jugement est féroce. Après, quand j’accepte ce premier constat, je vois le tableau autrement. Je sens alors qu’il s’est aussi passé quelque chose d’heureux. Il y a de la poésie, de la douceur. Les autres le voient tout de suite cela. Heureusement !
Lorsque j’avais entre la trentaine, je dessinais, je peignais et après je découpais car seule une partie m’intéressait et je la recadrais. Maintenant ce n’est plus nécessaire, je ne recadre plus. Une certaine unité se donne d’elle-même.
Quelle est ton approche ?
On me questionne souvent, dans les expos, sur le côté figuratif ou non de ma peinture. Comme s’il était difficile de la ranger dans ces catégories. C’est vrai que le débat sur le figuratif ou le non figuratif ne m’intéresse pas. En revanche si des choses doivent venir, j’essaie de me mettre dans une disposition intérieure pour qu’elles me traversent et qu’elles se manifestent sur la toile, qu’elles créent leur espace propre sur la toile. Je me fiche que la manifestation soit figurative ou non.
Là, en ce moment, une idée s’impose à moi : il faut que je me dépayse. Je crois que je vais arrêter d’aller à l’atelier où je peins actuellement. Il faut vraiment que je voyage que je marche et que j’aille dans des endroits. Il faut que je me laisse traverser davantage. Je travaille encore : je suis enseignant-chercheur à l’université. J’ai un quotidien, parfois routinier. J’essaie de vivre cela au présent grâce au yoga et à la méditation. J’y arrive et c’est un grand bonheur. J’adore travailler avec les étudiants. Je voudrais me laisser davantage traverser par l’énergie de la vie, je cherche ça. J’ai fait quelques petites expériences, ces deux trois dernières années, et c’est une source pour moi. Je devrais me dévouer davantage à ça.
Longtemps, j’ai essayé de laisser arriver les accidents. Maintenant je trouve que les accidents sont la petite partie visible de l’iceberg, cela se cultive. Je veux me laisser davantage faire par le tableau, par la couleur. Dans ma vie quotidienne, j’en fais l’expérience de temps en temps. C’est comme des petits évènements et cela m’apporte des petits bonheurs. Avec un modèle, là, dans le rapport à l’autre, cela peut se faire. Car ce qui me traverse, traverse aussi les autres gens, tous les vivants, mêmes les animaux, les plantes. Il y a une oie dans la campagne près d’ici, on peut dire qu’elle n’est pas différente des humains : elle est traversée par ce même élan magnifique. Quand un modèle pose à l’atelier, son corps est traversé par le même élan que celui qui me traverse, par la même énergie et cela me touche profondément. Je nous sens reliés. Quand on a des modèles, on a 4 à 5 minutes pour attraper cela. Même lorsque le temps de pose est d’une minute, je prends le temps de me laisser toucher. C’est uniquement comme ça que la vie qui nous relie sera dans le trait ou dans les vides entre les traits sur la toile.
Cela me rappelle quand je peignais enfant. Je me laissais complètement absorber par la simplicité et l’évidence de l’essentiel…
La peinture était un peu thérapeutique finalement au début pour moi. Il y a encore deux ou trois ans, quand je me mettais au travail, j’avais pour objectif d’attraper la lumière. Maintenant je dirais que je veux entendre bruisser le silence. Le silence me motive au-delà de tout. J’ai éprouvé cela il y a quelques temps et maintenant je recherche de plus en plus le silence. Une temporalité et des espaces de silence qui s’ouvrent, c’est très vivant et le silence, c’est très lumineux aussi. Aujourd’hui, si j’ai une ambition c’est celle-ci : faire place au silence.
Aimes-tu particulièrement des peintres, lesquels ?
Oui, des peintres comme George De La Tour, comme Vermeer… Chez ces peintres, pour moi, les choses sont comme suspendues. Les personnages sont seuls, dans un atelier, ils lisent une lettre, regardent un enfant dormir, une chandelle brûler, s’assoient devant un clavecin. Ce qui me plait dans ces tableaux, c’est la suspension qu’opère le silence dans la scène la plus simple de la vie quotidienne. Dans cette suspension, le silence ouvre le jeu : il dévoile les formes de tous les possibles à venir. Dans mes périodes de retrait du monde, j’étais couchée dans le salon toute la journée. Je voyais un salon que personne ne voyait car à ces moments–là de la journée, il aurait dû être vide. Après, il y avait le salon du soir : mon père, ma mère mon frère et, certains soirs, des amis, y séjournaient. Cela donnait une vie de salon. Mais moi, je vivais aussi l’envers du décor, le vide de ce plein et le silence de cette émulation. Du coup, je suis comme corporellement prise, avec bonheur maintenant, dans la suspension des choses, dans un « vivre dans l’envers des choses », dans l’envers de leur habitation habituelle. Je suis marquée par cette manière-là d’habiter le monde. C’est comme ça.
Dans tes toiles tu nous montres des harmonies colorées originales, fais-tu des recherches en ce sens?
Ceux que je côtoyais aux beaux-arts me disaient « ces deux couleurs, l’une à côté de l’autre, c’est improbable ». J’ai toujours aimé les rapprochements improbables même dans d’autres disciplines. Dans mon métier de chercheur, par exemple, si on fait une vraie trouvaille, une trouvaille qui change vraiment quelque chose, c’est une chance. J’en ai fait une qui a été reconnue comme telle. J’ai fait cette trouvaille grâce au rapprochement de deux faits connus de tous dans la discipline mais que personne n’avait jamais rapprochés.
Je vois que tu cernes les formes, pourquoi ?
Cela me vient probablement du travail avec le peintre Joël Monnier. Il appelle ça « graphisme ». Cela me vient probablement aussi du dessin : le trait reste une expression forte chez moi. Mais, le temps passant, je vois que j’y ai de moins en moins recours. J’utilise les trois couleurs primaires et les mélange sur la toile. Je les laisse « se trouver », manifester un possible qui va se donner sous le jour de l’improbable. Quand j’en suis en même temps surprise et ravie, je garde. On m’a dit parfois que le jaune était très présent dans mes tableaux. Peut-être que j’ai arrêté trop tôt le processus ? En même temps, la plupart des tableaux sont faits en deux-trois heures en atelier. Il faut que je me donne plus de temps. J’ai travaillé une fois sur un long terme, plusieurs semaines, mais cela ne me correspond pas : je n’arrive pas, dans ces conditions, à me laisser conduire par le tableau.
Quant à la couleur, c’est une ouverture pour moi. Je dessine depuis longtemps et je dessine bien. Je peux très bien reproduite une photo mais cela ne m‘intéresse pas. Entre 30 et 35 ans, J’ai copié des travaux d’autres artistes et ai beaucoup appris comme cela. Je travaillais avec René Koering, Directeur Festival de Radio France et de Montpellier. Il est compositeur. Il m’avait dit qu’il avait gagné sa vie, au début, en recopiant des partitions musicales pour un éditeur et qu’il avait beaucoup appris par ce travail. Quand j’étais petite et dessinais avec mon père, la copie était interdite…. Mais comme je trouvais pertinents les propos de Koering, je me suis essayée à copier des tableaux de maître. J’ai ainsi beaucoup appris à mon tour. Ce qui m’a le plus étonnée, c’est comment le peintre s’autorise de formidables libertés dans les réalisations les plus académiques.
Tu travailles en atelier avec un peintre ?
Oui, avec Joël Monnier, cela fait environ 6 ans. Nous peignons des paysages, inspirés de ceux que Joël a photographiés et projette sur grand écran. Des natures mortes qu’il installe pour nous. Des modèles viennent poser pour des portraits et des nus. On se retrouve entre amis et c’est ce que j’aime. Nous aimons peindre ensemble. Ensuite nous déballons notre repas. Nous parlons de nos tableaux et de beaucoup d’autres sujets. C’est très bienfaisant et formateur.
Travailles-tu chez toi ?
Oui, je n’y prends pas de modèle. Je commence souvent après une séance de yoga qui elle-même ouvre sur un moment de méditation. Quand là, je vois des formes mouvantes, j’essaie alors de passer à la peinture en laissant le corps continuer de faire… Le « savoir-faire » du corps, c’est une très bonne direction pour moi. A la fac, je dirige une ligne recherche sur l’idée que le corps sait mieux que la tête ce qui est vrai pour lui. On travaille à quelques-uns sur « l’accès à la performance » artistique ou sportive. Je suis convaincue que mon corps, mieux que ma tête, « sait » les choses justes. Je constate que, plus je persiste sur cette voie de l’élan corporel, portée par ce qui me traverse, plus émergent des formes riches et originales. Le monde vécu prend alors une autre tournure : il s’éclaire et s’éclaircit ! Même une tâche routinière devient alors prodigieusement vivante et vivifiante. Ce chemin, c’est une sorte d’aventure pour être.
Quelle serait ta direction ?
Pour moi, peindre ainsi, c’est favoriser l’ advenue d’un moment de vérité. C’est une quête liée aussi à l’âge et à la maturité. Laisser advenir cette vérité de soi, c’est très difficile. Je ne sais pas si avant de quitter cette vie je vais arriver à la plénitude d’une telle expression. Cela passe par le silence. Car je crois que la justesse d’une incarnation s’épanouit dans la suspension silencieuse du monde visible. J’essaie de faire éclore un espace de vérité qui sonne juste. J’estime que c’est la mission de tout être vivant, incarné. Je pense que le mieux du mieux c’est que la vérité se donne en partage, à un moment donné. Le partage c’est le top du top ! Ça demande un dévouement comme une ascèse.
La pratique quotidienne du yoga m’engage sur ce chemin-là. Souvent, j’en garde les traces toute la journée, quand je vais travailler. Alors, c’est génial. Les autres le sentent et viennent vers moi autrement, d’une manière plus vraie aussi. Les choses sont alors moins carrées, moins conformes pour nous ensemble. Les étudiants comptent beaucoup pour moi. Je les aime, comme les patients que j’ai eus, d’un amour « agapè », pas érotisé mais profond et respectueux. Je ne le leur dit pas car cela risque de les encombrer mais je crois qu’ils le sentent. L’autre jour, je vais à un colloque. Deux jeunes femmes contrôlaient les billets à l’entrée. L’une m’a dit « vous vous souvenez de moi ? J’étais une de vos étudiantes il y a 14 ans ». Je lui ai répondu « non, je ne vous ai pas reconnue ». Elle m’a répondu « nous on est plusieurs à ne pas avoir oublié les moments avec vous ». Je l’ai remerciée. Pour moi, ce témoignage compte car il est le signe qu’il y a eu un moment de vérité partagée entre nous, dans les interstices inavoués qu’instaure tout système, fût-il celui de l’université. Cette création, comme toutes les créations, révèle qu’il y a toujours un espace pour « exister en liberté », dans toutes sortes de situations, même les plus contraignantes, et chacun d’entre nous peut y trouver à espérer. Pour moi, peindre c’est donner forme à la vie en moi qui va vers plus de liberté.




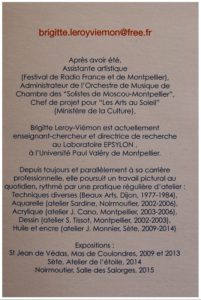
 Previous Post
Previous Post Next Post
Next Post


